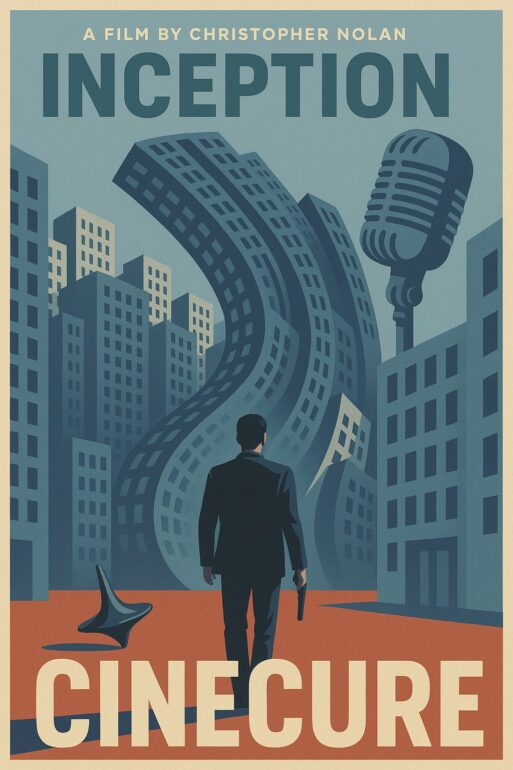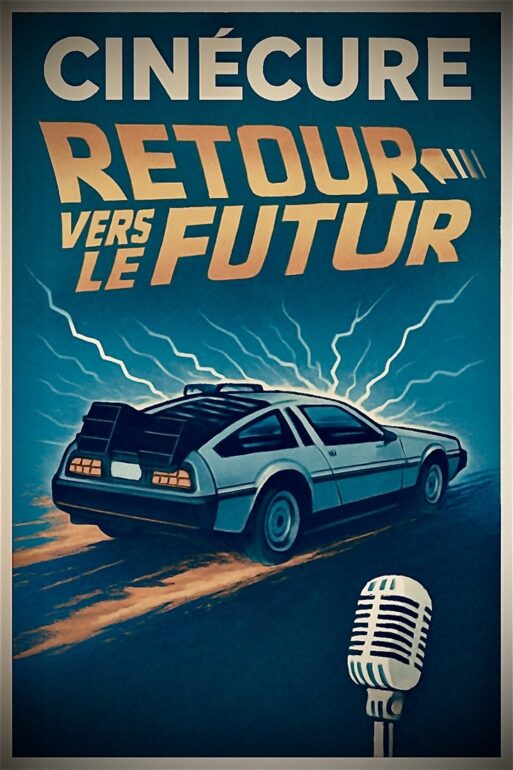
play_arrow
Highlander: le secret que vous n’avez jamais vu.

-
 play_arrow
play_arrow
Highlander: le secret que vous n'avez jamais vu. Laurent Goudet
Highlander: le secret que vous n’avez jamais vu.
Un autre regard sur le cinéma. Un regard qui se souvient de ce que disait Nietzsche : « Si tu regardes longtemps dans un abîme, l’abîme regarde aussi en toi. »
Qu’est-ce que ça veut dire ? Regarder l’abîme, c’est contempler la part obscure du monde, sa propre part sombre. Et si l’on y reste trop longtemps, cette obscurité finit par s’imprimer en nous, nous transformer.
Et si c’était là le pouvoir du cinéma ? Qu’à force de le regarder, il parvenait lui aussi à nous transformer ?
Ce soir, nous plongeons dans un film culte, électrique, inclassable : Highlander (1986). Un film de fantaisie, d’épée et d’immortalité. Derrière son vernis kitsch des années 80, ses éclairs et la musique de Queen, se cache une surprise : une véritable tragédie métaphysique.
Car Highlander, ce n’est ni plus ni moins que l’histoire d’un homme condamné à vivre éternellement et à porter le poids de la conscience. C’est le mythe de Prométhée revisité, une fable sur la solitude, la mémoire et la transformation. Il ne peut en rester qu’un. Et c’est dans Cinécure.
Le Feu et la Croix : Le Mythe Prométhéen
Highlander est une tragédie déguisée. Il raconte la plus ancienne des histoires : celle de l’homme qui, en voulant dépasser sa nature, se retrouve condamné à en porter le fardeau. C’est, à sa manière, le mythe de Prométhée revisité.
Dans la mythologie, Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Ce feu, c’est la connaissance, la conscience. Il arrache l’humanité à son animalité, mais au prix d’une malédiction : savoir, c’est souffrir. Le feu éclaire, mais le feu brûle.
Dans Highlander, le feu volé prend la forme de l’immortalité. Connor MacLeod n’a rien demandé, mais il reçoit un don divin : il ne peut pas mourir. Ce don est une lumière, mais aussi une croix. Il l’arrache au cycle naturel de la vie et de la mort, le condamnant à voir périr tout ce qu’il aime. L’immortalité devient ici l’équivalent moderne du feu prométhéen : un savoir interdit, une conscience trop vaste pour le cœur humain.
Zeus, furieux, punit Prométhée en l’enchaînant à un rocher, où son foie est dévoré chaque jour, pour l’éternité. C’est la métaphore de la souffrance éternellement recommencée. Connor MacLeod, lui aussi, est enchaîné à sa conscience. Les siècles défilent, les visages s’effacent, mais les émotions demeurent. Il est condamné à ne jamais oublier, à revivre la douleur encore et encore, comme un Prométhée moderne dont le foie est remplacé par le cœur.
Devenir « Un » : L’Individuation par l’Épée
Comment survivre à ce fardeau ? La transformation de Connor s’enclenche lors de sa rencontre avec Ramirez. MacLeod vient d’être banni, rejeté par les siens parce qu’il a survécu à la mort. Il est différent, il ne rentre plus dans les cases.
C’est alors qu’apparaît le guide, le mentor. L’échange est capital :
Ramirez : Tu ne peux pas mourir, MacLeod. Accepte-le. Connor MacLeod : Je te déteste ! Ramirez : Bien. C’est la meilleure façon de commencer.
Tout est là. Pour se transformer, il faut souvent passer par la colère. Avant de grandir, il faut accepter. Avant d’accepter, il faut comprendre. Et avant de comprendre, il faut affronter la vérité qu’on ne veut pas entendre.
On ne peut pas guérir de ce que l’on nie. On ne peut avancer qu’en acceptant ce que l’on est. Ramirez invite Connor non pas à renier sa différence, mais à la maîtriser : « Tu dois apprendre à […] exploiter ton pouvoir ».
C’est ce voyage qui donne son sens au leitmotiv du film : « Il ne peut en rester qu’un. »
Ce « Un » final, ce n’est pas un guerrier qui triomphe des autres. C’est un être humain qui s’est enfin trouvé. Un être qui, après avoir traversé les épreuves, se tient debout, entier, réconcilié. C’est ce que le psychanalyste Carl Gustav Jung appelait le processus d’individuation : le chemin pour devenir vraiment soi-même, pas ce que les autres attendent de nous.
Pour devenir complet, dit Jung, il faut oser regarder ce que l’on cache : nos peurs, nos colères, nos faiblesses. C’est ce qu’il appelle l’ombre.
Dans Highlander, l’ennemi juré, le Kurgan, n’est pas seulement le méchant. Il est l’ombre de Connor. Il est sa part violente, sauvage, dominatrice. Le combat final n’est pas qu’un duel physique ; c’est le combat intérieur de Connor contre sa propre part obscure. Quand il le vainc, il ne détruit pas son ombre : il l’intègre. Il devient complet.
Le Paradoxe de la Solitude Moderne
Le coût de ce voyage, c’est la solitude. L’un des aspects les plus poignants du film est le poids du temps. La scène où Connor regarde sa femme, Heather, vieillir à ses côtés pendant que lui reste jeune, est bouleversante. Il est condamné à aimer des êtres mortels tout en restant hors du temps. C’est la solitude de celui qui voit tout changer, sauf lui.
Cette solitude n’est pas choisie au départ, elle est subie. Et elle résonne étrangement avec notre condition moderne. La psychiatre Marie-France Hirigoyen analyse cette transformation : nous vivons dans une société hyper-connectée, mais de plus en plus seuls. Nous sommes « connectés techniquement, mais déconnectés émotionnellement ». Nous avons peur d’être seuls, mais encore plus peur de dépendre de quelqu’un.
Comme Connor, l’individu moderne est autonome, mais souvent isolé.
Highlander montre la sortie. Ramirez apprend à Connor à transformer cette solitude subie en solitude choisie, ou féconde. La scène où il court avec le daim, où il « ressent la vie », n’est plus un enfermement, mais une connexion à l’énergie du monde. C’est une retraite intérieure qui permet de se reconstruire.
Le paradoxe ultime du film survient à la fin. C’est au moment où Connor est le dernier, donc « totalement seul », qu’il accède au Prix : la « capacité de sentir les pensées et les émotions de tous les humains ». C’est seulement en s’acceptant pleinement seul qu’il devient capable d’entrer en relation véritable avec tous.
Le Vrai Prix : Refuser l’Éternité
Mais le film offre un dernier avertissement. « Il ne peut en rester qu’un » est aussi une métaphore du coût de la réussite absolue, du perfectionnisme poussé à l’extrême. Oui, Connor a gagné. Mais il a tout perdu pour y parvenir.
C’est la solitude du sommet. Dans nos vies, nous cherchons souvent à être le meilleur, à avoir raison « quitte à perdre la relation ». Le Prix de Highlander en amour, c’est la solitude des personnes qui ont toujours raison.
Refuser le Prix de Highlander, c’est choisir la coopération plutôt que la compétition. C’est comprendre que dans une équipe, si vous gagnez seul, vous perdez ensemble. Le bon manager n’est pas celui qui reste seul debout, mais celui qui fait grandir les autres.
Alors, ça vous dirait de devenir immortel ?
Pour le philosophe Spinoza, la vraie immortalité n’est pas celle de Highlander. L’éternité n’est pas ce qui dure ; c’est ce qui est vrai, ici, maintenant. La vraie immortalité n’est pas dans la trace qu’on laisse, mais dans la qualité de présence qu’on déploie.
Vous vivez une petite forme d’immortalité chaque fois que vous ressentez de l’amour, que vous êtes saisis par la beauté du monde, que vous créez quelque chose. Dans ces moments-là, vous ne pensez plus au temps. Vous êtes pleinement vivants.
Et ça, pour Spinoza, c’est déjà un morceau d’éternité.
L’émission est terminée. J’espère qu’elle n’aura pas semblé durer une éternité. Parce que, comme disait Woody Allen : « L’éternité, c’est long, surtout vers la fin. »
-
 play_arrow
play_arrow
Highlander: le secret que vous n’avez jamais vu. Mathieu ROMAIN
Podcast: Play in new window | Download
S'abonner à nos podcasts Apple Podcasts | RSS | More