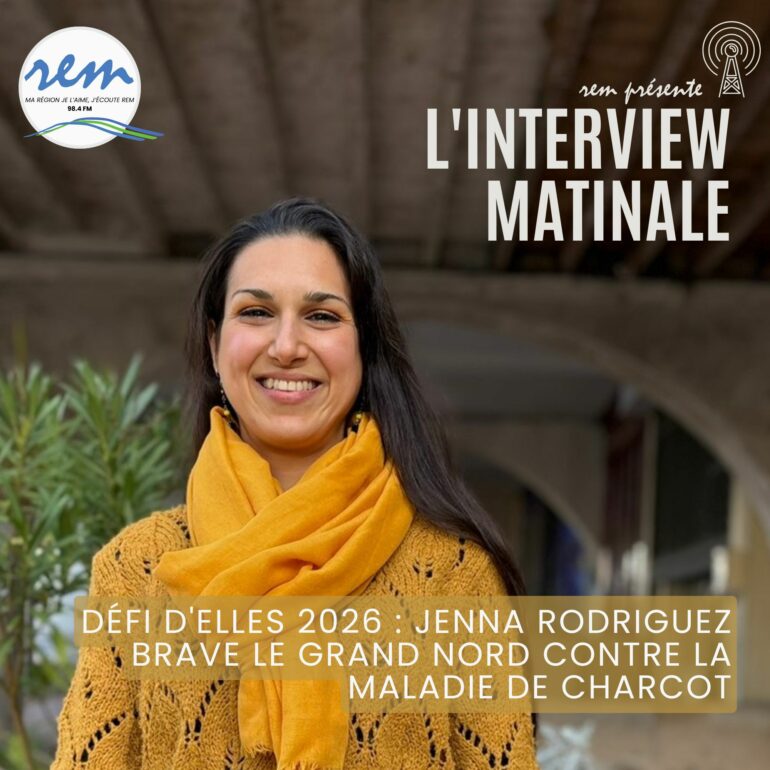
play_arrow
Olivier Razemon : Le marché, antidote à la mort des villes

-
 play_arrow
play_arrow
Olivier Razemon : Le marché, antidote à la mort des villes Mathieu Romain
Olivier Razemon a la patience de l’enquêteur. Face à la « mort programmée des centres-villes », un diagnostic qu’il a lui-même posé dans son livre « Comment la France a tué ses villes », il ne se contente pas de pleurer. Il revient avec « On n’a que du beau : le marché, ingrédient d’une société heureuse », non pas pour se lamenter, mais pour proposer une solution. Une solution qui est là, sous nos yeux, chaque semaine : le marché.
Cette solution, c’est le marché. Et pour la comprendre, Razemon a refusé l’impressionnisme. Son analyse n’est pas celle d’un flâneur, mais celle d’un mécanicien social. Son approche, précise et didactique, l’a conduit à énumérer ceux qu’il est allé voir : les commerçants, bien sûr, mais aussi le « placier », les « élus qui sont en charge du marché », les « sociétés concessionnaires », jusqu’au « Congrès de la Fédération des des commerçants des marchés ». Il a voulu « expliquer comment ça fonctionne », démonter le mécanisme de cette « génération spontanée » qui n’en est pas une.
Le miracle de la probabilité
Ce qui fascine Olivier Razemon, ce n’est pas seulement le produit. C’est la structure. Le marché, explique-t-il, est un « moment unique et un lieu unique » précisément parce qu’il est éphémère. C’est sa rareté – « une fois par semaine » – qui crée l’événement et force la rencontre. « Dans une ville de 5 000 habitants », calcule-t-il, « comme c’est une fois par semaine, on est sûr de rencontrer des gens ». C’est une simple question de « probabilité mathématique ».
Il décrit cet espace comme un lieu de sociabilité et « d’approvisionnement », un lieu où les gens « font quelque chose ensemble ». Un lieu où l’on apprend, en tendant l’oreille dans la file d’attente, que « cette voisine qu’on connaît pas très bien, bah finalement elle achète beaucoup plus ce week-end parce qu’elle va accueillir ses petits-enfants ». C’est un théâtre de la vie locale qui fonctionne à ciel ouvert, « à la merci des éléments », où l’on « mange des huîtres à 11h du matin un mardi sous la pluie ».
Il brosse le portrait de ce « paysage commercial » : un écosystème de 140 000 âmes (contre 400 000 en 1980, précise-t-il), où le producteur local côtoie « l’approvisionneur » indispensable, où les « passagers » saisonniers redessinent la carte des saveurs au fil de l’automne. Un lieu où les commerçants, pour la plupart, « gagnent plutôt bien leur vie », parce que leur métier repose sur une compétence clé : « le contact humain ».
Les prédateurs du lien
Le propos d’Olivier Razemon se durcit sensiblement lorsqu’il évoque les menaces. Le mot qu’il emploie est sans équivoque : les marchés ont des « prédateurs ». « La grande distribution », dit-il, « essaie de cannibaliser » et de « bouffer le marché ».
Sa stratégie ? Le mimétisme. D’abord, en créant des rayons d’hypermarché qui « ressemblent vaguement à des marchés ». Ensuite, et c’est plus insidieux, en développant des « halles gourmandes » ou « halles privées » dans les centres-villes.
Razemon pointe la différence fondamentale : « comme c’est ouvert tout le temps, […] on a beaucoup moins de probabilité de rencontrer les gens qu’on connaît ». En détruisant le caractère éphémère de l’événement, la grande distribution « singe » le marché mais en tue l’essence : le rendez-vous social.
L’angle mort des politiques publiques
Alors, pourquoi ce formidable outil de revitalisation est-il si souvent ignoré des urbanistes et des politiques ? « Je me suis beaucoup posé la question », admet Razemon.
Les réponses qu’il avance sont celles d’un homme qui s’est heurté à l’inertie administrative.
- Le marché est éphémère : il n’apparaît pas « dans les plans locaux d’urbanisme ».
- Ses acteurs sont ambulants : ils « viennent pas forcément aux réunions ».
- C’est « compliqué » : on y compte en « mètre linéaire » et non en « mètre carré ».
Mais la raison principale est peut-être la plus simple : le marché est victime de son évidence. On le considère comme « un fait acquis », un folklore qui a « toujours été là » et qui, pense-t-on, le sera toujours.
Pourtant, Olivier Razemon nous alerte. Cet espace de résilience, ce dernier lieu où l’on s’approvisionne « en produits frais » dans des bourgs désertifiés, est menacé. Il n’est pas un décor. Il est, pour reprendre son terme, un « antidote ». Un antidote fragile, vivant, et profondément humain.
-
 play_arrow
play_arrow
Olivier Razemon : Le marché, antidote à la mort des villes Mathieu ROMAIN
Podcast: Play in new window | Download
S'abonner à nos podcasts Apple Podcasts | RSS | More







